La neutralité carbone en 2050 ?
Les scientifiques et les agences publiques élaborent des scénarios relatifs à l’objectif de neutralité carbone. Aux trois échelles française, européenne et mondiale, ces scénarios supposent toujours de puissants changements de production, de consommation et, plus largement, de comportement. Défi inédit pour l’humanité, atteindre la neutralité carbone en 2050 semble aussi capital qu’incertain.
Voilà maintenant plus de cinquante ans qu’a paru le rapport Meadows sur Les limites à la
croissance 1
. Des chercheurs alertaient pour la première fois sur les limites climatiques et
écologiques du modèle de développement des sociétés humaines. En réponse,
les cinquante dernières années ont été marquées par une succession de
conférences internationales et d’accords de principe sur la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre (GES). Au cours de la même période, la
concentration atmosphérique en CO2 a augmenté d’un tiers.
La neutralité carbone, nouveau cap international
La coopération internationale concernant l’enjeu climatique a notamment été marquée
par l’accord de Paris de 2015, un traité juridiquement contraignant qui impose à ses
193 parties de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C d’ici à
la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle et même, de
préférence, à 1,5 °C. Pour cela, la neutralité carbone devient le nouvel
objectif à atteindre. Cette neutralité carbone est définie comme
« l’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ». Elle consiste ainsi à limiter les
émissions de GES à des niveaux permettant leur stockage pérenne dans les puits biologiques
(forêts, océans, etc.) ou géologiques (formations rocheuses souterraines).
La neutralité carbone s’est ainsi imposée à l’échelle internationale et a
ensuite progressivement motivé des déclinaisons par un certain nombre d’États, notamment
les États-Unis (d’ici à 2050), la Chine (d’ici à 2060) et l’Inde
(d’ici à 2070). Néanmoins, les trajectoires d’émissions de GES de la
majorité de ces pays sont jusqu’à présent très éloignées de la
neutralité carbone. À l’échelle internationale, les émissions de GES ont presque
été multipliées par trois depuis 1960. Elles ont repris leur hausse après la
parenthèse Covid de 2020. En conséquence, atteindre la neutralité carbone supposerait de
diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par
rapport à 1990.
Au niveau de l’Union européenne, c’est le paquet Fit for 55, adopté en 2021,
qui détermine les objectifs climatiques des États membres. Il constitue une déclinaison encore
plus ambitieuse de l’objectif international, puisque cette orientation impose une réduction des
émissions des États membres de 55 % à l’horizon 2030, et la neutralité
carbone en 2050. De plus, à la suite de l’invasion de l’Ukraine, la Commission
européenne a adopté la stratégie REPowerEU afin d’accélérer la
transition énergétique et ainsi réduire la dépendance des États membres au gaz
russe. Entre 1990 et 2020, l’UE a diminué ses émissions de GES de près
d’un tiers, soit bien au-delà de son objectif, qui était de les réduire de 20 %
2
. Néanmoins, le calcul des émissions n’intègre pas les émissions dites
« importées », correspondant à celles générées dans des
pays tiers pour la fabrication de biens et de services destinés aux pays membres. Or, il est estimé
qu’un tiers de l’empreinte carbone totale de l’UE est lié à ses importations 3
.
Fin 2022, l’UE a, par ailleurs, instauré une taxe carbone à ses frontières, afin de
pénaliser les importations les plus polluantes dans quelques secteurs : fer, acier, aluminium, ciment,
engrais et production d’électricité. Cette mesure inédite à l’échelle
internationale vise notamment à inciter les entreprises des pays tiers à améliorer leurs
standards de production. Le mécanisme de taxation sera mis en place à partir de 2026
ou 2027, et couvrira alors 60 % des émissions industrielles de l’UE, avant d’être
élargi d’ici à 2030 à tous les secteurs pour lesquels il y a des risques de fuite de
carbone 4
.
Neutralité carbone en France : objectifs, premiers bilans et perspectives
En France, c’est la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 qui impose un objectif de division
par 6, au moins, des émissions de GES d’ici à 2050, afin d’atteindre la
neutralité carbone.
Cette loi fixe aussi un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale
de 50 % entre 2012 et 2050 (– 20 % d’ici à 2030), et une
réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles entre 2012 et 2030. Par
ailleurs, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe des objectifs chiffrés et établit des
budgets carbone sectoriels.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit les priorités d’action et
les mesures opérationnelles concernant les politiques énergétiques nationale et sectorielles.
En 2019, la France adopte sa première loi de programmation sur l’énergie et le climat
(LPEC), qui comporte plusieurs axes : réduction des émissions de GES réduction de
la consommation énergétique développement des énergies renouvelables
diversification du mix de production d’électricité rénovation
énergétique dans le secteur du bâtiment autonomie énergétique des
départements d’outre-mer.
Les premiers bilans de la mise en œuvre de cette stratégie de transition énergétique sont
mitigés. Les émissions de GES de la France ont certes diminué, mais de seulement 20 %
depuis 1990, hors émissions importées, qui, elles, ont continué à augmenter. Selon
le Haut Conseil pour le climat (HCC), la France devrait quasiment doubler le rythme annuel de réduction de
ses émissions de GES, pour atteindre – 4,7 % par an en moyenne sur la
période 20222030. Le HCC s’alarme aussi de la stagnation des émissions des transports et de
la diminution très lente de celles du secteur agricole 5
.
Comment pourrait se traduire l’objectif de la neutralité carbone pour la société
française ? C’est pour répondre à cette question que l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mené une vaste
réflexion prospective qui a abouti, en 2021, à la publication de quatre scénarios à
l’horizon 20506
. Ces scénarios reposent sur les mêmes données
macroéconomiques, démographiques et d’évolution climatique, mais se distinguent par des
priorités et des choix de société différents, et donc par des trajectoires distinctes
pour permettre à la société de devenir neutre en carbone.
Le premier scénario, baptisé « Génération frugale », se
caractérise par une transformation radicale des modes de vie, motivée par une dégradation du
contexte national et international. La priorité est donnée à la sobriété (donc
à la révision à la baisse des besoins et des consommations) et à un nouveau récit
de progrès social. Le deuxième scénario, « Coopérations
territoriales », permet d’atteindre la neutralité carbone grâce à la
mobilisation simultanée de l’ensemble des leviers (sobriété, efficacité,
décarbonation et puits de carbone) et à l’implication de tous les acteurs de la
société. Le troisième scénario, « Technologies vertes », se
caractérise par une forte décarbonation de l’économie française, permettant de
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Il constitue davantage un projet
industriel qu’un projet de société, et n’entraîne pas de remise en cause des modes
de vie. Enfin, le quatrième scénario, « Pari réparateur », repose
intégralement sur le potentiel des technologies pour compenser les impacts des activités des
industries et des ménages, sans les remettre en cause. L’accent est notamment mis sur la capture et le
stockage du carbone, ce qui, de fait, conditionne le succès de ce « pari » au rythme
des progrès et des investissements dans ces secteurs.
Les quatre scénarios prospectifs de l’ADEME comparés au scénario tendanciel
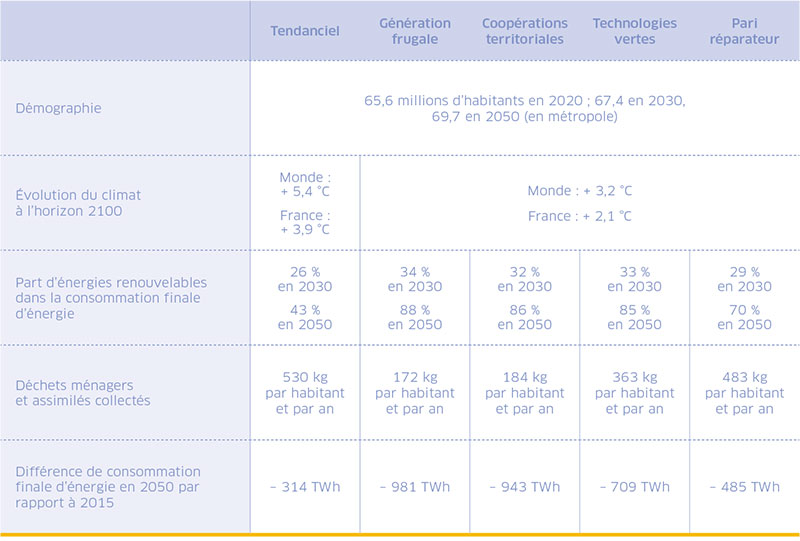
Ces différentes trajectoires constituent en quelque sorte des archétypes de société, qui
visent à montrer l’importance des choix collectifs mais aussi de la coordination des actions entre
court, moyen et long termes. En particulier, ces scénarios activent tous, mais à des degrés
divers, deux leviers : celui de la sobriété de l’offre et de la demande, mobilisable
dès à présent, et celui des solutions technologiques de long terme. Quel que soit le
scénario considéré, atteindre la neutralité carbone supposera de diminuer
significativement la consommation d’énergie de la France (de 23 % à 55 %), notamment
celle des carburants liquides, qui disparaissent quasiment dans toutes les trajectoires envisagées. Par
ailleurs, des investissements simultanés seront nécessaires dans la réduction des
émissions de GES et dans les puits de carbone. Or, le potentiel de ces puits est encore soumis à de
nombreuses incertitudes : vulnérabilité à la météo pour les puits naturels
(forêts, terres agricoles, etc.), manque de maturité des puits techniques (qui nécessitent des
développements d’infrastructures coûteux et parfois inédits).
Enfin se pose la question de l’impact des stratégies de transition énergétique sur la
trajectoire économique de la France (et plus largement des pays développés). Sur ce point,
l’ADEME se veut rassurante, en affirmant qu’aucun de ses scénarios n’entraînerait de
récession économique, tout en précisant que certains d’entre eux peuvent néanmoins
ralentir le taux de croissance potentiel. Ce sujet épineux méritera dans tous les cas des travaux
spécifiques au cours des prochaines années.
Les perspectives à l’échelle internationale
À quel rythme évolueront les émissions mondiales de GES au cours des prochaines
décennies, et la neutralité carbone pourra-t-elle réellement être atteinte ? Les
incertitudes dans ce domaine restant très fortes, notamment concernant les stratégies des plus gros
émetteurs, la Chine, les États-Unis et l’Union européenne représentant à
eux seuls plus de la moitié des émissions mondiales. À cette échelle
aussi, le recours à la prospective, notamment aux scénarios, est donc particulièrement utile
pour
mieux comprendre l'éventail des futurs possibles dans ce domaine.
En 2021, le GIEC a publié cinq nouveaux scénarios d'évolution possible des émissions
mondiales de GES et du réchauffement climatique aux horizons 2050 et 21007
.
Sur les cinq scénarios construits, un seul envisage que la neutralité carbone soit atteinte dès
2050, et ainsi que le réchauffement climatique soit maintenu en deçà de 1,5 °C d'ici
à 2100, comme le prévoit l'accord de Paris. À l'inverse, le scénario le plus pessimiste
envisage une élévation moyenne du climat de 4,5 °C d'ici à la fin du siècle. Les
experts du GIEC se montrent aussi très prudents concernant le potentiel des puits de carbone naturels, et
alertent concernant les risques associés aux techniques de séquestration artificielle du carbone.
Émissions de CO2 dans les cinq scénarios (SSP) de futurs climatiques du GIEC
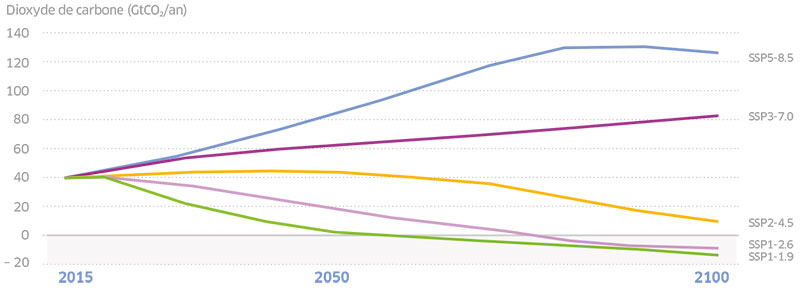
Source : sixième rapport d'évaluation du premier groupe de travail du GIEC, 2021.
Les impacts globaux des changements de température
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
.jpg)
Source : sixième rapport d'évaluation du premier groupe de travail du GIEC, 2021.
En parallèle, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publie chaque année, dans son rapport
World Energy Outlook, un panorama mondial des énergies ainsi que des scénarios à l'horizon
2050. Selon l'édition 2022, dans un scénario tendanciel, les énergies non renouvelables (ENR)
pourraient représenter près de 30 % du mix énergétique mondial en 2050 8
, et ainsi
dépasser légèrement le pétrole, le charbon et le gaz. Néanmoins, ces
progrès seraient insuffisants pour atteindre la neutralité carbone, qui exigerait que les ENR
représentent 70 % du mix énergétique mondial d'ici à trente ans. Parai lèlement,
la part du charbon et du pétrole devrait être divisée par cinq, afin qu'ils ne
représentent plus que 10 % du mix mondial. Atteindre une telle trajectoire supposerait, selon l'AIE, des
investissements annuels de 4000 milliards de dollars par an.
En 2021, dévoilant son scénario de neutralité carbone en 2050, l'AIE avait provoqué un
séisme dans le monde de l'énergie9
. L'agence est en effet largement perçue comme l'organe
mondial de référence en matière de prospective énergétique. Dans ses travaux,
elle intègre les divergences fondamentales existantes en matière de stratégie nationale
bas-carbone. Elle ajoute la contrainte d'un accès universel à l'énergie dès 2030,
conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU. Quelques mois avant la COP26, l'agence
dressait sa feuille de route mondiale pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les
mesures préconisées sont drastiques: renoncer dès à présent à tout nouveau
projet d'exploration pétrolière ou gazière et. dès 2035, à la vente de voitures
thermiques. L'AIE le reconnaît dans son rapport, le chemin qu'elle préconise implique un
bouleversement économique et géopolitique sans précédent.
Le chemin tracé par l'AIE pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 dans le monde
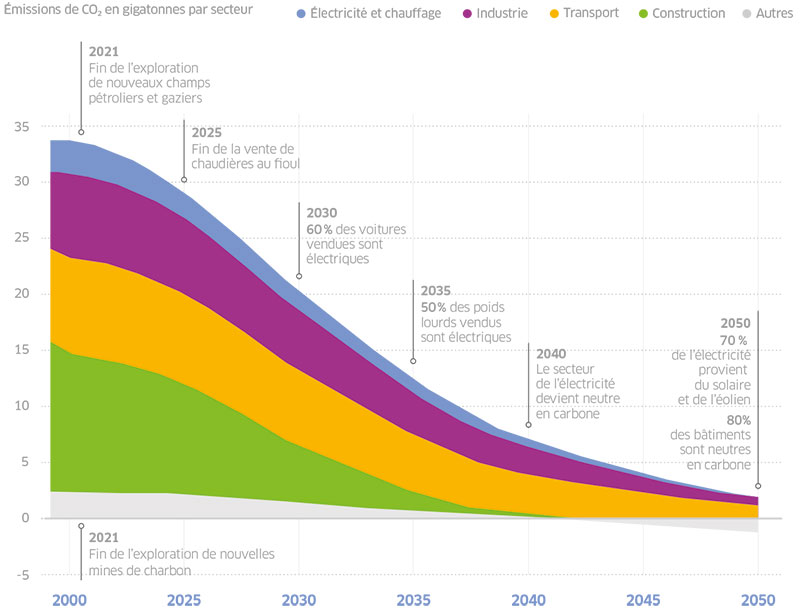
Source : AIE, Les Échos .
Les perspectives envisagées n’incitent pas les chercheurs à l’optimisme : dans une
tribune publiée fin octobre 2021 par le groupe de désobéissance civile Scientist
Rebellion, plus de 1 000 scientifiques d’une cinquantaine de pays affirment qu’il
n’est plus possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici
à 2100 10
. De même, 92 auteurs du rapport de 2021 du GIEC ont répondu à une
enquête de la revue scientifique de référence Nature : 60 % d’entre eux
estiment que le réchauffement climatique dépassera les 3 °C d’ici à la fin du
siècle 11
.
Pour finir, signalons que l’objectif de neutralité carbone présente deux limites majeures.
D’une part, il est souvent détourné par des acteurs (notamment des entreprises, mais aussi des
collectivités) qui revendiquent d’être eux-mêmes neutres en carbone, principalement
grâce à des actions de compensation. Or, la neutralité ne peut avoir de sens qu’à
l’échelle mondiale, ou éventuellement à l’échelle d’un État qui
l’orchestre de manière systémique. D’autre part, l’attention qu’il suscite
conduit à négliger
chercheurs du Potsdam Institute for Climate Impact Research et du Stockholm Resilience Center ont
mis au point le concept de « limites planétaires » 12
. Selon eux, sur les neuf limites
planétaires identifiées, six sont considérées comme dépassées, ce qui
signifie que la planète n’est plus capable d’absorber ni de compenser les impacts des
activités humaines. Il s’ensuit que des dégradations globales des caractéristiques
environnementales et géophysiques de la Terre s’observent. Outre le changement climatique, ces limites
concernent les pertes de biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et
du phosphore, les changements d’utilisation des sols (artificialisation), l’introduction de nouvelles
entités dans l’environnement (métaux lourds, plastiques…) et l’utilisation de
l’eau douce. Or, le franchissement de ces limites et leurs impacts combinés (effet cocktail) risquent
de conduire à des situations totalement inédites pour le vivant, notamment pour
l’humanité.
- Les limites à la croissance – connu aussi sous le nom de « rapport du Club de Rome
», ou encore de rapport Meadows, du nom de ses principaux auteurs, les écologues Donella Meadows et
Dennis Meadows – est un rapport commandé par le Club de Rome et publié en 1972.
- www.touteleurope.eu/environnement/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-l-union-europeenne/.
- « Un tiers de l’empreinte carbone de l’Union européenne est dû à ses
importations », INSEE Analyses, no 74, 2022. www.insee.fr/fr/statistiques/6474294.
- Voir « L’Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses
importations industrielles », Le Monde, 13 décembre 2022.
www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/13/l-union-europeenne-adopte-une-taxe-carbone-aux-frontieres-pour-verdir-ses-importations-industrielles_6154133_3244.html.
- Voir les travaux du HCC sur son site : www.hautconseilclimat.fr.
- Voir le site dédié à cet exercice de prospective : https://transitions2050.ademe.fr/.
- Ces travaux sont disponibles sur le site du GIEC www.ipcc.ch.
- Ces rapports sont disponibles sur le site de l'agence: www.iea.org.
- Le 18 mai 2021. l'AIE a publié un rapport intitulé Net Zero by 2050 a roadmap for the global energy sector Cette feuille de route a été réalisée à la suite de la demande de la présidence britannique de la COP26. www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.
- https://signon.scientistrebellion.com/.
- « Top climate scientists are sceptical that nations will rein in global warming »,
Nature, 1er novembre 2021. www.nature.com/articles/d41586-021-02990-w.
- Sur ces travaux, voir une synthèse sur le site
www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html.
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2023-3/la-neutralite-carbone-en-2050.html?item_id=7853
© Constructif
Imprimer
Envoyer par mail
Réagir à l'article