
© Le Figaro / Richard Vialeron
est directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (Ined)
Portrait d’une France qui vieillit
La part des personnes âgées de plus de
60 ans dans la population totale est passée de 16% en 1950 à
22,1% en 2000. Elle sera de près de 33% en 2050.
L’Europe est le continent de plus basse fécondité
au monde. Nulle part le remplacement des générations n’y
est assuré. Mais il y a cependant trois Europe, aux régimes
de fécondité très différenciés.
Le premier est le modèle maritime de l’Atlantique
Nord (Angleterre-France- Scandinavie) où depuis un quart de siècle,
la fécondité n’est inférieure que de 10% à
20% au niveau de remplacement des générations (2,1 enfants
en moyenne par femme) : la baisse de la population peut être compensée
ou évitée par une immigration modérée, maîtrisée.
Le deuxième est celui de l’Europe centrale
continentale (Allemagne, Pays-Bas, Autriche...), où le déficit
atteint 20% à 35% ; dans certains cas, la population a commencé
à fléchir et l’immigration joue déjà
un rôle majeur et parfois quasi-exclusif dans les variations démographiques.
Enfin, le troisième régime est caractérisé
depuis une dizaine d'années, voire plus, par un effondrement de
la fécondité jusqu'à des niveaux sans précédent
historique : 1,1 à 1,2 enfant en moyenne par femme (Europe méridionale,
Europe orientale, Russie...).
L'inversion de la pyramide des âges
Ces différences vont affecter la rapidité
et le degré de vieillissement démographique, mais ne vont
pas en changer la nature. Le processus est inévitable : il est
le produit de la baisse séculaire de la fécondité
et de l’augmentation des probabilités de survie aux âges
adultes et aux âges élevés.
La notion de vieillissement démographique a besoin
d’être explicitée. Il y a, en fait, trois définitions
communes : la plus ancienne, la plus simple et la plus utilisée
est « l’augmentation de la proportion des personnes âgées
dans la population totale ». Dans des sociétés traditionnelles
comme celles de l’Afrique sub-saharienne, la proportion de personnes
de plus de 65 ans est de 3% alors que le pourcentage correspondant vers
2050 dépassera les 30% en Italie, en Allemagne, en Russie, etc.
Il y a un second indice classique : l’âge
médian qui est l’âge qui divise la population en deux
parts égales, la première en dessous, la seconde au-dessus
de cet âge : aujourd’hui, cet âge est de 18 ans en Afrique
sub-saharienne (un continent d’enfants), alors qu’en Europe
et au Japon, il avoisine 40 ans et pourrait atteindre 50 à 55 ans
au milieu du présent siècle.
Mais la description la plus réaliste est reflétée
par le concept d’inversion de la pyramide des âges. La sous-fécondité
s’est diffusée dans toute l’Europe, ce qui signifie que,
contrairement aux attentes des dernières décennies, le nombre
d’enfants diminue et la taille à venir du potentiel de main-d’œuvre
va baisser : le poids des générations âgées
va augmenter, notamment dans les pays qui, comme la France, ont eu un
puissant baby boom, cependant que, au contraire, la taille des générations
jeunes va se réduire. D’où une divergence croissante
entre les deux extrémités de la pyramide des âges,
par exemple, entre le nombre de personnes âgées et le nombre
d’enfants, mais aussi entre le nombre de retraités et le nombre
d’actifs. Il y a donc bel et bien inversion, ou retournement de la
pyramide des âges : les personnes âgées ou vieillissantes,
jusque-là rares, deviennent nombreuses, voire majoritaires alors
que le groupe de jeunes, qui de tout temps prédominait, s’érode
avec la baisse de la fécondité, au point de devenir minoritaire.
Il y a un mouvement de pivotement autour de l’âge médian
(40 à 50 ans).
Historiquement, une « pyramide » des âges
passe ainsi par trois stades successifs :
-
le triangle (ou le sapin) : forte mortalité, forte fécondité
(contexte traditionnel) ;
-
le rectangle (ou la pagode) : basse mortalité, fécondité
proche du niveau de remplacement des générations. C’est
le cas de la France actuelle ;
Pyramide des âges de la France en 2002
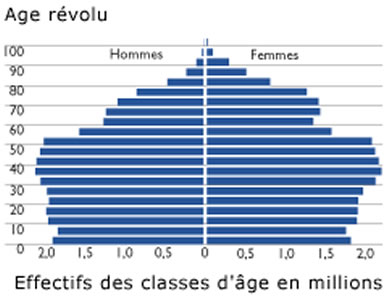
- le trapèze (ou le triangle inversé) ou encore le bonsaï
: basse mortalité, fécondité très faible,
très déficitaire, comme en Europe méditerranéenne
ou en Russie.
Une marche implacable
Le cheminement de la répartition par âge
en France à l’aune du premier indicateur est simple à
retracer. La part des personnes de plus de 60 ans dans la population totale
est passée de 16% en 1950 à 19,2% en 1975, puis à
22,1% en 2000. Le baby boom ne l’a donc pas empêchée
de croître de près de deux cinquièmes. Après
l’arrivée aux grands âges des générations
nombreuses nées entre 1946 et 1973 (vingt-huit classes pleines),
le vieillissement va connaître une formidable accélération,
qui se prolongera jusque vers 2035-2050 (et même au-delà
si la fécondité rechute). Toujours décrite par la
part des personnes de plus de 60 ans dans la population, la marche du
vieillissement est implacable : 22,9% en 2010 ; 26,8% en 2020 ; 31,5%
en 2035 ; 32,7% en 2050 ; autrement dit, un tiers de la population se
composera de personnes âgées. La proportion correspondante
double entre 1950 et 2050.
En cas de nouvelle baisse de la fécondité
jusqu’à 1,5 enfant par femme, le pourcentage serait largement
prédominant, avec 36% des habitants.
Toute aussi impressionnante est l’évolution
de l’âge médian : en 1975, juste au lendemain du baby
boom (qui provoqua un net rajeunissement), la moitié des habitants
avait moins de 32 ans ; en 2010, cet âge sera passé à
40 ans ; en 2050, dans l’hypothèse centrale, la moitié
des habitants auront plus de 45 ans, cependant que dans l’hypothèse
basse, cet âge médian atteindra 49 ans.
L’évolution comparée des effectifs
de jeunes et de personnes âgées est encore plus inattendue.
Dans toute population traditionnelle où n’existe aucun contrôle
sur la mortalité ni sur la fécondité, le nombre de
jeunes est de cinq à sept fois supérieur à celui
des personnes âgées. Avec la maîtrise de la fécondité,
cette différence s’amenuise et avec les progrès médicaux,
lorsque l’allongement de la durée de vie provient de la baisse
de la mortalité aux âges avancés, cet écart
fléchit encore. Mais c’est lorsque la fécondité
passe durablement en deçà du seuil de remplacement des générations
que se produit le tournant décisif. Ainsi, en France, en 1950,
la population comptait encore deux fois plus de jeunes de moins de 20
ans que de personnes de plus de 60 ans.
Evolution de la population de la France en extrapolation de 1950 à 2050
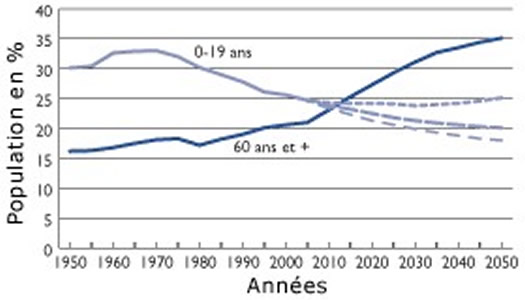
|
Effectif et répartition par âge
de la population de la France (1950-2050)
En millions
|
| Année
|
1950 - 1975 - 2000 |
2010
|
2020
|
2030
|
| |
B  M M H H |
B M M H
H |
B  M M
 H H |
|
Observations
|
Projections
|
| Population totale |
41,8  52,7 52,7
 59,2 59,2 |
60,7 61,2
61,2 61,5
61,5 |
61,2 62,4
62,4 63,5
63,5 |
56,4 61,8
61,8 67,7
67,7 |
| Jeunes = 20 ans |
12,5  16,9 16,9
 15,0 15,0 |
14,2 14,6
14,6 15,0
15,0 |
13,0 14,2
14,2 15,4
15,4 |
10,1 13,3
13,3 17,0
17,0 |
| Personnes âgées
(= 60 ans) |
6,8  9,5 9,5
 12,1 12,1 |
14,0 14,0
14,0 14,0
14,0 |
16,7 16,7
16,7 16,7
16,7 |
20,2 20,2
20,2 20,2
20,2 |
| Age médian (en
années) |
34,5  31,6 31,6
 37,6 37,6 |
40,6 40,3
40,3 40,1
40,1 |
43,3 42,5
42,5 41,8
41,8 |
48,9 48,9
48,9 41,6
41,6 |
|
|
L’exercice de projection comporte trois
variantes : variante basse, médiane et haute, liées
aux hypothèses de fécondité (il n’existe
qu’une hypothèse de mortalité et une hypothèse
de migration internationale).
Fécondité haute (H) :
reprise jusqu’à 2,3 enfants par femme en 2050 (au
lieu de 1,73 en 1995-2000)
Fécondité moyenne (M) : hausse légère
(1,9 enfant par femme en 2050
Fécondité basse (B) : poursuite de la baisse jusqu’à
une moyenne de 1,5 enfant par femme en 2050
Mortalité : hypothèse unique : allongement de la durée de vie moyenne de 6
à 7 ans (de 74,2 ans en 1995-2000 à 80,6 ans pour les hommes en 2045-2050 ; de 82 ans en 1995-2000 à 87,3 ans pour les femmes en 2040-2045)
Immigration nette constante (+ 40 000 personnes par an)
Sources : Brutel, C. : Projections de population
à l’horizon 2050. Un vieillissement inéluctable.
Insee Première, mars 2001, et surtout United Nations : World
population prospects 2000, New York, 2001.
|
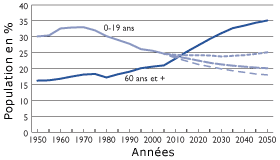 Dès 2010, alors que l’effectif jeune n’a guère varié,
l’effectif âgé a doublé, passant de 7 à
14 millions. L’irrésistible basculement se poursuit ainsi
: alors que le rétrécissement continue chez les jeunes (sauf
en cas d’hypothèse haute), la poussée s’amplifie
pour les personnes âgées, au point que le retournement est
total. Le nombre de personnes âgées est très supérieur
à celui des jeunes ; il est supérieur de moitié dans
le scénario central, il est double dans la variante basse.
Dès 2010, alors que l’effectif jeune n’a guère varié,
l’effectif âgé a doublé, passant de 7 à
14 millions. L’irrésistible basculement se poursuit ainsi
: alors que le rétrécissement continue chez les jeunes (sauf
en cas d’hypothèse haute), la poussée s’amplifie
pour les personnes âgées, au point que le retournement est
total. Le nombre de personnes âgées est très supérieur
à celui des jeunes ; il est supérieur de moitié dans
le scénario central, il est double dans la variante basse.
Des
conséquences nombreuses et variées
|
Evolution du rapport « nombre de personnes
âgées (60 ans et plus)/nombre de personnes en âge
de travailler
(20 à 59 ans) » en France
|
1950
0,30
|
2010  0,45
|
1975  0,36
|
2020  0,57
|
2000  0,38
|
2050  0,71
|
|
|
Source : Variante moyenne des projections
des Nations-Unies (2001).
|
Cette inversion se répercute sur le
rapport de dépendance, autrement dit sur la dynamique de la Sécurité
sociale. Le nombre potentiel d’inactifs âgés augmente
nettement plus vite que le nombre potentiel d’actifs (voir ci-contre).
En 1950, on comptait trois actifs potentiels pour un
retraité potentiel ; en 2050, la charge aura doublé : 1,4
actif potentiel seulement pour 1 retraité potentiel. La France
s’est dotée d’un système de retraite exceptionnel
: généreux, précoce, universel ; en même temps,
elle n’a pas su assurer la maîtrise comptable de ses dépenses
de santé (près de 10% du PIB). Elle risque de vivre des
lendemains difficiles, notamment si elle veut demeurer compétitive
et fortement exportatrice.
Au-delà de l’aspect financier, il y a la
délicate prise en charge des personnes très âgées
devenues invalides ; or l’inversion de la pyramide des âges
est telle que l’accroissement des effectifs est d’autant plus
fort que les âges considérés sont plus élevés
(triplement des personnes de plus de 75 ans, quadruplement des personnes
de plus de 85 ans d’ici à 2050).
C’est pour les personnes démunies et seules
que le problème social sera le plus aigu. La demande de services
(aide ménagère, par exemple), de logement adapté
aux handicaps et surtout d’hébergement médicalisé
va connaître un développement d’autant plus spectaculaire
que la crise de la famille (recul du mariage, hausse des unions libres
et des divorces) tend à affaiblir les solidarités traditionnelles.
Le secteur de l’habitat devra s’adapter à cette nouvelle
donne, par l’investissement en équipements et en personnel
spécialisés. Mais il faut aussi tenir compte d’un effet
inverse : l’avancée en âge s’accompagne d’une
diminution de la surface de logement occupée par personne.
Toutefois l’effet principal reste, à nouveau,
lié au vieillissement par le bas, c’est-à-dire à
la contraction du nombre de jeunes : entre 2000 et 2035, la proportion
des jeunes de 15 à 25 ans passera de 13% à 11% ; le nombre
de jeunes ménages, qui constituent le segment principal de la demande
de logement et d’équipement, ira décroissant (le nombre
annuel moyen de logements mis en chantier est tombé de moitié
entre le début des années 1970 et les années 1990).
Parallèlement, à partir de 2015-2020, le nombre de logements
libérés par les décès des premières
classes nombreuses issues du baby boom commencera à augmenter.
La dynamique démographique devrait donc tendre à stabiliser
le parc immobilier ; bien entendu, les opérations de réhabilitation
et les nouvelles demandes liées à la mobilité professionnelle
ou spatiale (infrastructures, résidences secondaires) joueront
en sens inverse, du moins si la conjoncture économique ouvre l’horizon.
Enfin, les changements matrimoniaux pourront modifier la nature de la
demande : le nombre de personnes vivant seules (pouvant ou non avoir un
visiting partner), et le nombre de foyers monoparentaux n’ont sans
doute pas fini de croître ; ce sont des logements de moindre taille
et plutôt situés en centre-ville qui pourraient, en raison
de cette miniaturisation des foyers, être davantage recherchés.
|
L’exponentielle de l’âge
Il y a un vieillissement dans le vieillissement. L’un des
points essentiels du processus global de vieillissement est, en
effet, le vieillissement démographique de la population âgée
elle-même. Par exemple, le nombre de personnes de plus de
80 ans augmente plus vite que celui de tout autre groupe d’âge
élevé mais moins âgé. De même,
la croissance du groupe d’âge 90 ans et plus, est encore
plus rapide. Le recul des risques de décès aux divers
âges de la vie est cumulatif ; c’est l’écoulement
du temps, la durée, c’est-à-dire l’âge
qui lui donne toute sa force en fin d’existence.
Prenons un exemple numérique, celui de la France de la première
moitié du XXIe siècle. D’après les calculs
perspectifs(1) des Nations Unies (2002), entre 2000 et 2050, la
population de plus de 80 ans devrait tripler : 2,173 millions en
2000, 6,443 millions en 2050 ; celle de plus de 90 ans devrait plus
que quadrupler : 430 000 et 1,749 million respectivement.
Enfin, le nombre de centenaires devrait être multiplié
par près de 15 (120 000 en 2050, au lieu de 8 500 en 2000).
Ceci alors que pour l’ensemble du groupe d’âge 65
ans et plus, le coefficient multiplicateur sera de 2,1 seulement
(20 et 9,3 millions respectivement).
Les plus grands âges avec leurs problèmes spécifiques
– même atténués par les avancées
de la médecine ou du mode de vie – cesseront d’occuper
une place marginale. La solitude, la dépendance, les conflits
d’héritage, le décalage entre les générations
prendront une dimension jusqu’alors inconnue.
|
Bibliographie
- Projections de population à l’horizon 2050. Un vieillissement inéluctable. C.Brutel, Insee Première, mars 2001
- Le crépuscule de l’Occident dans l’Union Européenne à l’horizon 2050. Une étude d’impact. Gérard Calot et Jean-Claude Chesnais, en collaboration avec Alain Confesson, Alain Parant et Jean-Paul Sardon. FuturiblesInternation n°6, octobre 1997, Paris 227p
- Maintaining prosperity in an ageing society. OCDE, Paris 1998, 142p.
- Le vieillissement démographique de la France : enjeux et politiques. Population et développement : les principaux enjeux cinq ans après la conférence du Caire. Alain Parant, Paris, Ceped (Centre d’études population et développement), 2001
- United Nations Population Division : World population ageing 1950-2050, New-York, 2002.
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2002-11/portrait-d-une-france-qui-vieillit.html?item_id=2434
© Constructif
Imprimer
Envoyer par mail
Réagir à l'article