Une ville passante ou des environnements sécurisés ?
Les périphéries de nos grandes villes
se construisent aujourd’hui massivement. C’est là que
se fabriquent, dans un nouveau partenariat privé/public, la plupart
des aménagements au coup par coup qui se cantonnent sur les friches
industrielles, commerciales ou résidentielles (les grands ensembles)
des faubourgs et de la banlieue. Les procédures de fabrication
de ces périphéries ont un impact sur les problèmes
de sécurité d’aujourd’hui et de demain : le premier
d’entre eux concerne la sécurité routière, et
le second, l’enclavement. Mais les deux sont en réalité
intimement liés.
La première des insécurités en France
est celle de la route ; certains y voient même la première
des « zones de non-droit » tolérée : violence
des comportements, conduite en état d’ivresse ou de fatigue
expliquent sans l’excuser cette spécificité française.
Mais l’objectif de fluidité et de déplacements rapides
sur l’ensemble du pays, retenu par les aménageurs du territoire,
a aussi sa part de responsabilité.
Y contribuent successivement la géométrie
routière, les giratoires et le partage de la voirie.
La
géométrie routière des voies rapides urbaines
permet aisément des vitesses en courbe et en sortie du réseau
à près de 100 kilomètres/heure ; de grands rayons
sont nécessaires pour les décélérations ;
ceux-ci, outre le fait qu’ils créent de nombreux
« délaissés de voirie » et procurent un sentiment
de vide et d’espacement considérable des objets entre eux,
déconnectent bâtiments et voies. De ce fait, la dépendance
automobile se crée, rendant peu sûrs, et quasiment incongrus,
les autres modes de transport. Elle les rend exogènes, voire inquiétants
: le deux-roues devient rôdeur, le piéton un vagabond suspect…
ou une victime potentielle.
Les
giratoires se sont répandus depuis vingt ans. Depuis qu’en
1984, le code de la route a introduit la priorité au véhicule
circulant sur la chaussée annulaire, le phénomène
a pris une ampleur unique au monde. Meilleure fluidité du trafic,
meilleure sécurité et diminution de la pollution en sont
les avantages reconnus. Emprise foncière considérable, perte
du sens de la géographie du territoire (symbole d’une société
qui tourne en rond comme on l’a même écrit), domination
de l’automobile par rapport à la desserte, aux traversées
des piétons et des deux-roues en sont quelques-uns des inconvénients
les plus souvent dénoncés. Progressivement, la prolifération
du giratoire a transformé les territoires. Exigés par les
riverains et les élus comme image d’entrée de ville
(avec les aménagements de micro-paysages, « nains de jardin
» qui en occupent les centres), ils contribuent, à force
d’accumulation, à détourner l’idée initiale
du giratoire. Leur démultiplication et leur sur-dimensionnement
contribuent à créer de mini-rocades autour des villages,
isolant les bourgs eux-mêmes.
Le
partage de la voirie : la spécialisation des voies selon leurs
fonctions et leurs modes de transport est à la mode : « sites
propres », « voie partagée », « voie citoyenne
», où chacun (rollers, automobilistes, transports en commun,
vélos, patinettes, handicapés…) pourrait cohabiter
en bonne intelligence, semblent une solution de bon sens apparent. Mais,
outre la véritable difficulté à mettre en œuvre,
dans les profils de la ville existante, toutes ces demandes cumulées,
le principe de la voie partagée favorise la vitesse maximale de
chaque mode et, de ce fait, l’insécurité des traversées.
Ce principe va, de plus, à l’encontre des études de
comportement des automobilistes qui ont montré que la perception
de nombreux obstacles dans un champ de vision rapproché favorise
l’attention et la prudence. Plus simplement, on sait bien que le
stationnement des voitures le long des trottoirs a de nombreux avantages
: desservir commerces et habitations riveraines, empêcher le stationnement
sauvage, garer les voitures… et protéger les piétons,
notamment les enfants, de traversées impulsives.
On le voit, les solutions toutes faites en matière
de sécurité routière comportent bien des effets pervers.
La sécurité dépend, en fait, de nombreux facteurs
sous-exploités : géométrie routière, formes
urbaines, code de la route, politiques de répression…, qui
ne nécessitent pas forcément des mesures ségrégatives
de la chaussée ou des quartiers.
Les
dangers de l’enclavement
« Sécurité et environnement »
: ce slogan de campagne électorale est, depuis quelque temps, traduit
auprès des maires par les opérateurs privés sous
la forme d’«environnements sécurisés »
: des morceaux de nature sous surveillance et à accès le
plus souvent payants : les fameux « parcs ». Les parcs étaient,
à l’origine, des domaines forestiers clos destinés
aux chasses seigneuriales. Ils ont été ouverts au public
après la Révolution, ce qui leur a donné l’image
positive de privilèges conquis. L’origine historique a fourni
le succès idéologique du terme. Accolé au business
ou aux loisirs, il cache mal cependant, derrière la récupération
souriante, à côté de ses origines cynégétiques,
un héritage militaro-industriel : celui des bases militaires d’après-guerre.
Ces avant-postes ont préfiguré les parcs d’activités
contemporains. Zones extraterritoriales, mono-fonctionnelles, hyper-surveillées,
enclaves sans enclos trop visibles, ils demeurent les places fortes (même
vertes), de la guerre économique. Et on compense l’isolement
par rapport aux populations et aux villes locales par des services et
un environnement surabondant, l’espace(ment) et la nature. Les parcs
sont en réalité des domaines réservés, privatisés.
Un second phénomène accompagne celui des
parcs en tous genres : celui des résidences surveillées
et des copropriétés ultra-réglementées. On
peut se rassurer en pensant que le phénomène n’est
pas nouveau et qu’il existait dans certaines banlieues cossues de
l’Ouest parisien ; la nouveauté consiste davantage dans le
fait qu’il tend à se généraliser aujourd’hui
auprès de couches moyennes dans le sud et le sud-ouest mais aussi
en Ile-de-France. Importés des Amériques, ces gated-communities
à la française sont plus modérées en apparence
que leurs cousins d’outre-Atlantique du fait d’une législation
plus rigoureuse en matière d’extra-territorialité ;
mais pour combien de temps ? Car, ne nous y trompons pas, ces programmes
vendus clés en main aux élus par des « ensembliers
urbains » répondent aux désirs croissants «
d’évitement scolaire », et de ségrégation
sociale, voire générationnelle.
Bien sûr, certaines formes de cours-jardins ou
de clos peuvent être des manières positives de concilier
voisinage, tranquillité et contrôle social ; mais lorsqu’elles
couvrent de vastes emprises, elles deviennent des enclos, voire des enclaves.
De plus, en rendant difficile, par leur taille et leur système
de voirie, l’accès d’autres terrains aux services publics,
elles les enclavent de facto.
Si ces grandes enclaves ont pu se développer,
c’est que, par un effet quasi-mécanique, l’extension
radioconcentrique de la périphérie autorise les grands terrains
peu coûteux, gagnés sur la déprise agricole ; les
opérateurs d’aujourd’hui exigent des terrains trop vastes
pour leur usage courant : les aires commerciales et de loisirs sont calibrées
sur les heures de pointe, les zones d’activités sur les extensions
futures et les parcelles résidentielles se tiennent à bonne
distance des voisins.
Il en résulte une réduction majeure de
l’espace public au sens strict du terme : un espace accessible à
tous et gratuit. Cette réduction s’accompagne d’une délégation
massive à la surveillance privée. Cette surveillance s’exerce
en apparence de manière d’autant plus légère
qu’elle est omniprésente. On est passé du barbelé
à la vidéo-surveillance. Mais cette omniprésence
rassure et inquiète à la fois, car, là-aussi, le
cycle insécurité/sentiment d’insécurité
est rapidement pervers : un fait divers local, amplifié par la
rumeur ou les médias, et les marchands de peur balisent la ville
de dispositifs de sécurité plus ou moins visibles sans pour
autant prouver leur efficacité dissuasive. Tout cela amplifie une
ambiance de ville peu sûre.
Ainsi, d’une demande citoyenne élémentaire
pour davantage de sécurité et d’environnement, on est
arrivé à une réponse : « l’environnement
sécurisé ». Mais parcs et résidences closes
sont des réponses à courte vue. La sécurité
de chacun ne peut se faire durablement que si elle ne suscite pas, par
effet miroir, l’exclusion puis le repli des autres.
La
ville n’est pas un arbre
L’étalement urbain, comme la concentration
physique de problèmes socio-économiques, peut aussi susciter
l’insécurité. Les statistiques de vols et d’agressions
dans les périphéries sont de plus en plus là pour
le souligner. Aussi, pour rester dans les métaphores écologiques
à la mode, peut-être faudrait-il rappeler à notre
aide et à notre souvenir le célèbre slogan formule
de Christopher Alexander : « Une ville n’est pas un arbre1
» car elle est sans doute la clé d’une structure urbaine
plus vi(v)able. Dans l’esprit d’Alexander, qui oppose l’arbre
aux structures en semi-treillis, « la ville ne doit pas être
un arbre » signifie que l’arborescence hiérarchisée
et en cul-de-sac de l’arbre, des racines à la feuille, ne
peut être celle d’une ville qui doit assurer la communication
entre presque toutes les feuilles. Les conditions de la vie urbaine supposent
un maillage quasi-continu de voies, une continuité de l’espace
public. Ce dernier principe a un rapport évident avec les questions
de sécurité. Chacun sait que le sentiment d’insécurité
commence à naître lorsqu’il y a menace mais, surtout,
absence d’aide possible : coincé au fond d’une impasse,
d’un appartement, d’un tunnel, hors de portée de vue
ou de voix des voisins, chacun d’entre nous, victime ou agresseur,
redoute et connaît ces lieux en cul-de-sac. Or ces dispositifs se
multiplient. Au nom de la tranquillité se crée l’insécurité.
Le voisin connu (de palier, de cour, de parcelle) ou l’automobiliste
inconnu (des rues et des boulevards de jour et de nuit) se raréfient.
Ils sont pourtant la première des préventions. C’est
ce que les services publics de transports commencent à comprendre
après avoir déserté les quais et les compartiments.
Ils réintroduisent des agents dans les gares et les wagons. Ne
pourrait-on s’éviter d’emblée ce cercle vicieux
en maintenant des passants sur la voie publique, des concierges dans les
immeubles et des commerçants dans les commerces ?
Encore faudrait-il que la ville contemporaine ne soit
pas un arbre. Rappelons-nous l’avertissement d’Alexander, qui
garde toute son actualité : « Pour l’esprit humain,
l’arbre est le véhicule le plus simple d’une pensée
complexe. Mais la cité n’est pas, ne peut être et ne
doit pas être un arbre. La ville est le réceptacle de la
vie. Si le réceptacle brise la superposition des stratifications
vitales dans son propre intérieur – en étant un arbre
– ce sera comme une boule hérissée de lames de rasoir
et prête à fendre tout ce qu’elle rencontre. Dans un
tel réceptacle, la vie sera mise en pièces. Si nous construisons
des villes en arbres, nos vies seront mises en pièces. »
Le
tracé des villes en débat
Plus techniquement, pour combattre ces enclavements programmés,
il nous faut substituer un urbanisme de tracés à un urbanisme
de secteurs, capable de donner sens et hiérarchie à la ville.
Il faut rompre avec les solutions toutes faites, externalisées,
extra-territorialisées qui homogénéisent les territoires
et, de ce fait, font disparaître les sentiments d’appartenance
collective et de respect des biens et des personnes. La géographie
physique donne du sens à la ville. Elle permet d’habiter des
territoires qui, sinon, deviennent homogénéisés,
anonymes, passe-partout, uniquement accessibles aux plus riches et aux
plus pauvres ou à leurs seuls habitants. Ils ne peuvent alors susciter
que l’indifférence.
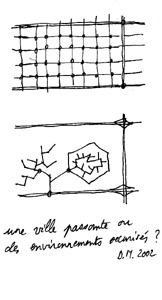 L’arborescence hierarchisée
L’arborescence hierarchisée
et en cul-de-sac de l’arbre
ne peut être celle d’une ville.
Au risque de passer pour angélique, on soutiendra
donc qu’un environnement de qualité, des espaces publics qui
engagent et méritent le respect sont le début de la vraie
sécurité. On demande aujourd’hui aux paysagistes et
aux architectes-urbanistes de révéler la géographie
initiale des sites à l’intérieur des grandes villes.
Mais il est souvent trop tard. Même s’ils méritent d’être
tentés, les efforts pour restituer, par exemple, visibilité
et accessibilité à une rivière ou à une colline
sont souvent illusoires ou ont un coût prohibitif.
Les enjeux prioritaires doivent concerner aujourd’hui
les projets d’extension des villes moyennes, des bourgs et des villages.
Car, s’ils sont soumis aux mêmes procédures et protagonistes,
de plus en plus influents auprès de communes sans moyens, on aboutira
aux mêmes résultats : de micro-agglomérations produiront
de micro-périphéries au lieu de projeter une continuité
territoriale et une diversité de paysages urbains et agricoles.
L’ensemble de ces questions sur le tracé
des villes est aujourd’hui en débat mais cela prend la forme
de querelles de spécialistes entre urbanistes-architectes et ingénieurs
de voirie, sans que les responsables élus ne mesurent réellement
les enjeux de société qu’ils recouvrent : par exemple,
lorsque les élus exigent aujourd’hui des ronds-points pour
régler un problème de sécurité routière
ou d’image d’entrée de ville, problèmes qui pourraient
être résolus autrement, ils ont du mal à percevoir
les conséquences urbanistiques qu’un giratoire à chaque
entrée de bourg peut susciter : nouvelles urbanisations découplées
de la vie du village, dépérissement des commerces et, en
d’autres termes, création d’une mini-périphérie.
Un
nouveau partage des responsabilités
D’autres solutions existent bien sûr : une
maille continue de voie et la réalisation de boulevards urbains
permettent dessertes riveraines, urbanisation des carrefours et la limitation
en nombre (et leur réduction en surface) des giratoires pour assurer
des
traversées piétonnes : mais cela suppose un nouveau partage
des responsabilités publiques/privées, un redécoupage
communal (sujet tabou) et que les valeurs de la vitesse et de l’individualisme
ne soient pas aussi prégnantes. Cela a sans doute un coût
à court terme : mais le coût social à moyen et long
terme, n’a-t-il pas, lui aussi, un coût économique considérable
?
En conclusion, à la question académique
traditionnelle « y a-t-il des dispositions urbaines plus criminogènes
que d’autres ? », on ne peut que répondre prudemment
: les grands ensembles de Neuilly ou de l’Ouest parisien sont vécus
comme de charmantes résidences. La promiscuité peut à
la fois être vécue par certains comme un sentiment d’appartenance
sociale ou renforcer, pour d’autres, un sentiment d’isolement.
On sait aussi que l’espacement lui-même est affaire culturelle
: la « dimension cachée » entre piétons ou voisins
d’ascenseur du Caire, de Tokyo, de Manhattan ou de Paris n’est
pas la même.
On peut cependant affirmer que certaines dispositions
favorisent plus que d’autres le renouvellement urbain : l’histoire
nous montre que les systèmes de voies en
cul-de-sac, les grands ensemble bâtis ou les grandes emprises foncières
sont plus problématiques en matière de gestion dès
que la situation économique et sociale devient difficile et les
modes de peuplement figés. Le moins que l’on puisse dire est
que ces quelques leçons urbanistiques ne paraissent pas guider
les forces du marché et ceux chargés de les réguler.
Au risque de construire aujourd’hui les grands ensembles – à
plat – de demain.
Bibliographie
- Acher Fr., Godard, Fr., « Vers une troisième solidarité », Quand la ville se défait, Esprit, n°258, 1999
- Alexander Ch., De la synthèse de la forme, Dunod
- Banderier J., Quels profils en travers pour les boulevards urbains, Certu
- Chambon Fr., « La lutte contre l’insécurité, entre enjeu public et dérives commerciales », Le Monde, 29 octobre 2000
- Delfou J.C, « La délinquance routière, soupape sociale », Libération, 16 juillet 2001
- Foucault M. , « Des espaces autres », conférence donnée en mars 1967, Dits et écrits, Gallimard-Seuil, 2001
- Guilly Ch., Atlas des fractures françaises, L’Harmattan, 2000
- Jaillet M.-Ch., « Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? », Esprit, n°258, 1999
- Le Gal Y., Les Ronds-Points, outils du déplacement urbain : l’exemple de Nantes, Cetu, Giratoire 92
- Paquot Th., Dossier : « Villes privées ou privatisées », Urbanisme 312, 2000
- Razac O., Histoire politique du barbelé, La Fabrique, 2000
- Treutel, Garcias, Treuttel, De l’espace libre à l’espace public, Recherche SCIC Puca, 1996
- Alexander, Ch. Une ville n’est pas un arbre, AMC, novembre 1967.
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2002-1/une-ville-passante-ou-des-environnements-securises.html?item_id=2409
© Constructif
Imprimer
Envoyer par mail
Réagir à l'article