La minocratie : compliquer pour régner
Davantage que la complexité, inhérente aux affaires humaines, c’est la complication qui est problématique. Celle-ci permet aux bureaucrates, publics ou privés, de bien vivre, aux dépens de ceux qu’ils doivent servir. Volonté de pouvoir des dirigeants et désir d’exister des techniciens se renforcent pour produire plus de textes et de contraintes et, finalement, conduire à la déshumanisation de la société. La nomocratie (gouvernement par la norme) dérive en minocratie (gouvernement par la complication).
Depuis des millénaires, l’exercice du pouvoir s’appuie sur une méthode éprouvée : diviser pour régner. Cette bonne vieille méthode est toujours en vigueur, mais il en est une autre, complémentaire, dont les lettres de noblesse sont également fort anciennes, et qui a pris une importance croissante, au point d’occuper aujourd’hui la première place : compliquer pour régner.
Le joug de la complication
Pourtant, les rapports entre le pouvoir et la complication n’ont pas fait l’objet de beaucoup d’analyses, et encore moins d’études destinées au vaste public des citoyens, des travailleurs et des consommateurs qui portent le joug de la complication créée par le personnel politique, administratif, managérial, commercial et financier. La complication est un instrument de pouvoir, un instrument essentiel, et on ne le sait pas, même si l’on s’en doute un peu. Il y a là une lacune à combler, un non-dit à expliciter, un phénomène souterrain à exposer au grand jour. Les matériaux ne manquent pas : les manifestations de la complication sont omniprésentes, et chacun de nous subit quotidiennement ses conséquences désagréables. Les raisons de lever le voile sont fortes, car la complication fait obstacle au fonctionnement d’une vraie démocratie et d’une économie agréable, au service des hommes. Il faut étudier les tenants et aboutissants de ce fléau pour découvrir les moyens d’en limiter l’ampleur.
La complication se dissimule volontiers sous l’appellation « complexité ». L’usage incessant de ce dernier mot conduit à une regrettable confusion conceptuelle. La complication au sens où nous l’entendons désigne une accumulation, due à l’action humaine, de mécanismes et de dispositions dont la complexité n’a pas d’utilité du point de vue de l’intérêt général. Elle correspond au dicton par lequel l’homme de la rue se moque – modeste revanche – de tous ceux qui lui compliquent la vie sans raison valable : « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »
La complication se différencie radicalement de la complexité naturelle des phénomènes physiques, chimiques, biologiques, psychologiques, sociologiques ou économiques, et de la complexité scientifique et technique des théories, modèles et instruments grâce auxquels les hommes cherchent à comprendre l’univers et à le mettre à leur service. Parangon symbolique de la complication, le Labyrinthe conçu par Dédale pour enfermer et cacher le Minotaure est éminemment artificiel ; il a pour fonction d’empêcher quiconque de s’orienter, de comprendre où il est et où il va en parcourant ses allées. Il témoigne d’une attitude diamétralement opposée à la démarche scientifique, laquelle s’efforce au contraire d’éclairer, de clarifier, de rendre compréhensibles les choses, les événements, les individus et les sociétés. La science schématise, simplifie en laissant de côté l’accessoire : Newton n’aurait pas conçu la loi de l’attraction universelle si son esprit était resté occupé par la diversité infinie des corps qui subissent et exercent la gravité. La connaissance est complexe seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour éclairer la réalité : le Labyrinthe est compliqué pour que certains faits, certaines vérités, certaines actions restent inaccessibles au commun des mortels.
La complication foisonne dans de nombreux domaines : la législation et la réglementation, la finance, les modes de rémunération, la tarification des services, les contrats, l’information, etc. Cela n’est pas le fruit du hasard : la complication est utilisée comme méthode de gouvernement et d’enrichissement, comme technique de dissimulation de la vérité, comme instrument de pouvoir sur les hommes.
La complication : instrument et résultat du pouvoir
Compliquer est particulièrement utile pour exercer le pouvoir par la ruse plutôt que par la force, pour dépouiller autrui de façon insidieuse plutôt que violente. Un vol à main armée est simple : « la bourse ou la vie ». Une arnaque, une escroquerie ne font pas appel à la violence, à la menace brutale, mais à la dissimulation, aux flots d’informations inutiles et fastidieuses qui rendent très compliquée, et ipsofacto difficile, la recherche de l’information utile. Une réduction en esclavage est brutale ; un contrat de travail alambiqué, des lois difficilement compréhensibles, des procédures électorales tirées par les cheveux sont des techniques d’assujettissement qui entraînent moins d’opposition et requièrent moins de force tout en étant assez efficaces. La complication permet ainsi à des acteurs ne disposant que d’une puissance matérielle modeste, ou dont la position juridique est fragile, de dominer néanmoins d’autres acteurs, éventuellement plus puissants ou plus légitimes.
Elle facilite également l’exercice du pouvoir aux personnes et aux organismes qui ne possèdent pas les moyens intellectuels nécessaires pour gouverner avec simplicité. Rappelons-nous cette phrase attribuée à l’un des esprits les plus subtils de notre histoire, Léonard de Vinci : « La simplicité est la sophistication suprême. » Élaborer des lois simples requiert de remarquables aptitudes d’analyse et de synthèse, une capacité rare à comprendre le fonctionnement des systèmes complexes. Prenons une comparaison : il est relativement facile de construire une petite route qui monte, descend et tournicote quand le relief est tourmenté ; concevoir et réaliser une autoroute qui enjambe les vallées grâce à des viaducs et passe sous les collines grâce à des tunnels est le fruit d’un travail d’ingénierie beaucoup plus complexe, qui ne peut être mené à bien que par des équipes très compétentes. Une entreprise de TP aux qualifications rustiques peut construire une route du premier type, qui fait de la conduite des véhicules une sorte de casse-tête, mais pas une autoroute, la voie de circulation qui simplifie la conduite !
Il en va de même en matière de gouvernement : peu d’hommes politiques, peu d’équipes formées d’hommes politiques et de hauts fonctionnaires ont les compétences qui leur permettraient de concevoir des réformes simplificatrices ; il est plus à la portée de présidents, ministres, parlementaires et chefs de services administratifs « normaux » d’ajouter encore et encore de ces dispositifs dont l’empilement aboutit aux codes énormes et indigestes auxquels nous sommes malheureusement soumis ! C’est pourquoi les voies juridiques de la plupart des pays, dont la France, sont des routes à lacets éreintantes à parcourir plutôt que des autoroutes. La complication du droit, des institutions et des mesures politiques n’est pas seulement un instrument de pouvoir, mais aussi le résultat de l’exercice du pouvoir législatif, exécutif et administratif par des acteurs politiques dont les talents sont plus axés sur la conquête des postes que sur l’art de légiférer et de gouverner. Mutatis mutandis, on observe un phénomène analogue dans beaucoup de grandes firmes et autres grandes organisations privées. La complication est en partie un sous-produit de la détention du pouvoir par des personnes qui ne sont pas à la hauteur des responsabilités auxquelles elles ont accédé, des personnes qui parviennent à empiler les dispositifs mais pas à les combiner de façon à former un ensemble cohérent et harmonieux.
Nous avons dit que la complication se dissimule notamment en se faisant passer pour de la complexité. Cette dissimulation et l’importance des enjeux expliquent que les Anciens aient abordé ce sujet en utilisant le genre littéraire qui a servi de tout temps à parler des choses délicates de la vie d’une manière codée, difficile à comprendre pour les non-initiés : la mythologie. René Girard a montré comment les mythes, archaïques et modernes, constituent La Voix méconnue du réel2 et révèlent à qui sait les décrypter Des choses cachées depuis la fondation du monde3. La relation entre le pouvoir et la complication est une des clés du mythe du Minotaure tapi au centre du Labyrinthe. Ce mythe, que Bertrand de Jouvenel avait déjà associé au pouvoir 4, est particulièrement accessible à nos esprits forgés par la culture grecque.
(…)
Règles nécessaires et normes inutiles
Quand des hommes s’efforcent de dominer d’autres hommes pour le plaisir que cela procure de commander, de se sentir supérieur, rendre service aux simples citoyens n’est plus un but, mais un moyen pour se faire nommer ou élire à un poste intéressant. Et le pouvoir n’est plus un moyen, mais un but en soi. Alors, ne pourrait-on concevoir et vivre l’autorité plutôt comme une fonction au service d’autrui ? La formule « serviteur de l’État » va dans ce sens, quand bien même il serait préférable de dire « serviteur de la population » ou « gardien et promoteur de l’intérêt général ».
L’exercice de l’autorité est en effet nécessaire pour organiser une société où il fasse bon vivre. Quantité de règles sont envisageables, mais il faut choisir, et assez souvent choisir arbitrairement : la conduite à droite n’est pas intrinsèquement meilleure que la conduite à gauche, mais les déplacements deviendraient un vrai casse-tête si, dans un périmètre donné, une autorité reconnue n’avait pas opté soit pour la conduite à droite, soit pour la conduite à gauche. Édicter une telle règle est nécessaire pour éviter un effroyable désordre, des embarras de la circulation, des empoignades, des accidents : c’est un service à rendre à la population.
Parfois de telles conventions se forment spontanément au sein d’un groupe social, ou du moins sans intervention d’un législateur, sans réglementation officielle. Une institution aussi importante que la monnaie peut émerger ainsi, on l’a observé en maintes circonstances, depuis les univers concentrationnaires ou carcéraux jusqu’aux sociétés d’immigrants sur un territoire où ils se trouvent livrés à eux-mêmes, ou encore avec le bitcoin, exemple récent de phénomène de ce genre, mais ce n’est pas toujours le cas, loin de là. Et lorsque la société grandit, le législateur est le bienvenu pour conforter les conventions nées avant lui.
(…)
Une société est policée si elle possède un ensemble de règles encadrant le comportement de ses membres, les unes résultant d’un consensus quasiment spontané (des règles de politesse, par exemple), tandis que d’autres sont imposées par une autorité reconnue. Mais elle est policière si elle est soumise à beaucoup de normes inutiles édictées par des pouvoirs publics qui punissent les contrevenants.
Une société policée a besoin de pouvoirs publics, y compris une force publique, des tribunaux et des institutions carcérales, pour protéger les personnes et les regroupements de personnes contre les membres de la société qui nuisent à autrui en s’affranchissant des règles de bonne conduite forgées par la coutume ou par le législateur. Ces autorités ne cherchent pas à imposer les comportements qui ont leur préférence, mais à éviter que des trublions causent du tort à leurs concitoyens en transgressant les règles aussi simples et limitées que possible qui sont nécessaires au vivre-ensemble. Dans une société policière, en revanche, les autorités estiment être investies du droit de dicter leur conduite aux citoyens, qu’elles considèrent plutôt comme des sujets que comme des concitoyens. Elles sanctionnent les individus et les organisations qui enfreignent les normes arbitraires qu’elles ont mises en place au même titre, et parfois avec plus de vigueur, que ceux qui contreviennent aux règles de juste conduite issues de la sagesse des nations, c’est-à-dire d’une lente maturation au cours de laquelle les générations successives acquièrent la connaissance du bien et du mal, de l’utile et de l’inutile.
Plus une société est policière, plus le pouvoir y est lié à la complication. Pourquoi cela ? Dans une telle société, les règles et les actions publiques sont un enjeu de compétition entre personnes et groupes qui s’efforcent d’imposer celles qui ont leur préférence ; et pour ce faire presque tous les coups sont permis : le législateur et l’autorité réglementaire peuvent faire à peu près n’importe quoi, ajouter, retrancher, modifier au gré de leur humeur et des rapports de force qui s’établissent entre leurs composantes. Les codes deviennent alors des capharnaüms où les obligations, les exceptions, les exceptions aux exceptions, s’empilent sans que les fonctionnaires qui assistent le personnel politique, surchargés par son activisme, aient le temps de réorganiser, de mettre de l’ordre.
La complication est ainsi liée à la boulimie d’hommes de pouvoir qui entendent imposer leur volonté, et cela aussi bien dans le domaine des affaires, des entreprises, que dans la sphère politique. Autrui, en tant qu’être humain, leur importe assez peu : c’est un administré, un client, un salarié, qui constitue une sorte de matière première ; il faut donc le formater, l’amener à se comporter comme on l’entend, donc le soumettre. Il n’est pas question, sauf en paroles, de se mettre à son service. Le chef n’a pas pour projet de servir, mais de se servir des autres pour atteindre ses propres objectifs, les buts qu’il s’est fixés plus ou moins arbitrairement, souvent davantage pour avoir une raison et de diriger que par conviction.
Le dirigeant altruiste, réellement soucieux des autres, et ipso facto désireux de leur rendre service, ne cherche pas à compliquer par tactique : il joue franc jeu. S’il faut, par exemple, augmenter la pression fiscale pour résorber un déficit public, il ne va pas simultanément procéder à des réductions d’impôts plus ou moins ciblées pour donner l’impression qu’il se soucie des petites gens : il les respecte suffisamment pour les associer, dans une juste proportion, à l’effort de redressement. Il ne cherche pas à séduire une « clientèle » en prenant en sa faveur des mesures particulières qui compliqueraient inévitablement le dispositif législatif et réglementaire. De plus, ayant comme objectif l’intérêt général et non le déroulement de sa carrière, il consacre son temps à travailler les dossiers et à diriger les administrations dont il a la responsabilité : il ne cherche pas à faire parler de lui en multipliant les initiatives normatives élaborées à la va-vite en réponse aux faits divers fortement médiatisés, surchargeant ainsi nos codes de textes qu’il faudra ensuite corriger, voire partiellement abroger, en raison de leur mauvaise qualité. Bref, un dirigeant « serviteur de l’État » et de ses concitoyens, ou de ses clients, de ses salariés et de ses actionnaires, produirait aussi peu de complication que possible. Il s’occuperait de résorber la complexité inutile qui encombre nos lois et règlements, en préparant soigneusement les quelques réformes systémiques, organisationnelles ou techniques qui simplifieraient considérablement la vie des ménages et des entreprises, par exemple l’unification de nos régimes de retraite par répartition et la division par deux ou plus du nombre des impôts et taxes ; et il orienterait ses ingénieurs et techniciens vers la mise au point d’appareils simples à utiliser et la rédaction de notices faciles à comprendre par les utilisateurs néophytes.
Pour la simplification
La complication de nos lois et règlements a atteint un tel niveau que leur simplification serait véritablement une œuvre de salut public. Mais il ne faut pas oublier la complication qui gangrène le système financier et pourrit la vie des ménages en tant que consommateurs, usagers, salariés ou responsables d’entreprise. L’élimination de certains abus requiert une réglementation, mais pour l’essentiel il en va de la vie économique et sociale comme de la vie politique : la solution n’est pas un supplément de textes, mais un supplément d’âme, en commençant par la déontologie professionnelle et la bonne vieille morale, qui doivent incorporer l’exigence de simplicité comme celle de respect des générations futures.
Michel Crozier disait avec raison que l’on ne change pas la société par décret ; c’est vrai également de chaque homme en particulier. La moralisation de la finance, par exemple, ne sera pas obtenue par la multiplication des interdits minutieusement explicités, même s’il en faut quelques-uns : elle passe davantage par un sursaut des consciences, conduisant les professionnels à ne plus jouer sur la complication pour refiler des mistigris, comme dans l’affaire des subprimes ; elle passe aussi par un moindre formalisme juridique, de façon à ce que la justice puisse sanctionner des opérations qui sont évidemment malhonnêtes, même si elles sont suffisamment bien montées pour passer entre les mailles du filet judiciaire classique. Dans le domaine des affaires, comme dans d’autres, c’est l’excès de juridisme qui complique, parfois jusqu’à la rendre impossible, la nécessaire répression des comportements nocifs.
La lutte contre la complication relève ainsi largement de la maxime qui figure dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens : « la lettre tue, c’est l’esprit qui vivifie ». La parole de l’apôtre, probablement inspirée par plusieurs paroles et gestes de Jésus appelant à dépasser le formalisme compliqué des anciens rites, nous propose un fil d’Ariane permettant de sortir des labyrinthes. La complication bâtissant des mondes d’apparence trompeuse, c’est dans le réalisme et le bon sens qu’elle est soluble.
Un ouvrage original, dans le dédale hexagonal
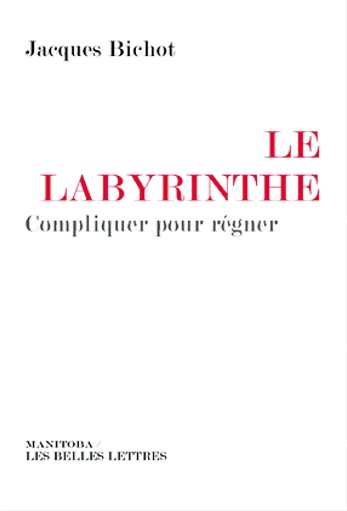
Jacques Bichot nous guide à travers les recoins des labyrinthes juridiques et bureaucratiques français (fiscalité, politiques sociales, monde de la finance, etc.). Ce sont des jeux de piste pour les spécialistes, mais des parcours du combattant pour les quidams (beaucoup plus nombreux). Fin lettré et spécialiste de l’horlogerie socio-fiscale, Bichot développe une théorie : la complication est utile aux bureaucrates, dans le secteur public comme dans celui de l’entreprise. Mieux, il propose un néologisme, forgé à partir du mythe du Minotaure. Monstre fabuleux, mi-homme mi-taureau, ce dernier est enfermé par Minos dans le labyrinthe. Situé au centre de la Crète, le labyrinthe est construit spécialement par Dédale afin que le Minotaure ne puisse s’en échapper. Qu’est-ce donc que la « minocratie » ? C’est l’organisation sciemment élaborée par les pouvoirs des différents labyrinthes dans lesquels nous errons.
Alors que tout le monde déplore la complexité, Bichot prend acte de son inéluctabilité. Il s’en prend à la complication croissante et superflue. Abondance de normes nuit à l’humanité et à la prospérité. Les exemples, allant de la finance de marché à la sécurité sociale en passant par la CSG, la TVA, les barèmes des impôts, la tuyauterie alambiquée du financement des prestations sociales, valent le détour. Tout comme les fausses simplifications qui sont accumulations de nouveaux dispositifs. L’ensemble est une peinture détaillée et argumentée de la « minocratie » : le gouvernement par la dissimulation et la complication. La devise de cette minocratie n’est pas « diviser pour régner » mais « compliquer pour régner ». Toutes les flèches ne sont pas réservées au secteur public. Le secteur privé (du turbocapitalisme financier déconnecté des réalités aux activités intrusives et invasives de phoning et de marketing) en prend pour son grade. Cette plongée dans différents labyrinthes français (et européens) montre que la simplicité est caractéristique d’une société policée. Et que la complication est l’outil d’une société policière.
Julien DAMON.
- Ces développements sont extraits de l’ouvrage de Jacques Bichot, Le Labyrinthe. Compliquer pour régner, Paris, Manitoba-Les Belles Lettres, 2015.
- Ouvrage paru en 2002 aux éditions Grasset & Fasquelle.
- Ouvrage paru en 1978 aux éditions Grasset.
- Bertrand de Jouvenel a choisi la figure du Minotaure, durant la période où sa pensée prit une tournure libérale, pour symboliser le pouvoir excessif et monstrueux se nourrissant des malheureux humains, mais il n’a pas tiré parti de son habitat, le Labyrinthe, ni des autres aspects du mythe minoen, pour mettre en évidence les rapports du pouvoir et de la complication. Deux de ses ouvrages constituent une charge contre le pouvoir insatiable : Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance (1945) et The Ethics of Redistribution (1951). L’introduction du premier s’intitule « Présentation du Minotaure », qui fut successivement « masqué » puis « à visage découvert » et enfin « partout ».
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2025-10/la-minocratie-compliquer-pour-regner.html?item_id=7980
© Constructif
Imprimer
Envoyer par mail
Réagir à l'article