Le rôle social de l'officier
Paru initialement dans la Revue des Deux Mondes en 1891, ce célèbre texte du futur maréchal de France lance un débat sur le service militaire universel, pour la jeunesse, et sur l’action éducatrice de l’armée, au-delà de sa fonction purement militaire. Leçon générale, à faire méditer à tout dirigeant et à tout agent du management : l’officier doit connaître et aimer ses hommes
Depuis l’application intégrale du service obligatoire,c’est-à-dire depuis hier, c’est, de vingt à vingt-trois ans, toute la nation, sans exception, qui passe entre ses mains ; nul n’y échappe. Il ne s’agit plus ici de tel ou tel groupe de travailleurs ; tous, ouvriers de la main et de la pensée, lettrés et ignorants, propriétaires et laboureurs, reçoivent, pendant une période de leur vie, l’empreinte d’un lieutenant, d’un capitaine, d’un colonel.
À ce fait tout nouveau — ce fait révolutionnaire au sens propre du terme —, doit répondre forcément un développement du rôle de l’officier, dont lui-même n’a, croyons-nous, pas encore pris conscience ; dont, en tout cas, il ne nous semble pas qu’on ait été suffisamment frappé au-dehors.
Depuis vingt ans, une succession de régimes transitoires — service de cinq ans, volontariat, dispenses — a préparé le régime actuel ; mais, entre le dernier contingent d’une armée où le remplacement épargnait le service à tout ce qui avait quelque culture et ce contingent de 1890 qui, du licencié à l’illettré, va comprendre tous les intermédiaires, la « matière soldat », si l’on peut s’exprimer ainsi, a radicalement changé. À ce soldat nouveau, il faut, logiquement, un officier nouveau. C’est celui dont nous allons essayer de tracer la mission, et c’est à ce point de vue initial qu’il faudra constamment se reporter pour ne pas se troubler d’une conception du rôle de l’officier qui s’éloignera peutêtre du type un peu rude et exclusivement batailleur que ce nom, à tort ou à raison, avait le don d’évoquer.
Nul n’est mieux placé que l’officier pour exercer sur ses subordonnés une action efficace. En contact immédiat avec eux, il partage entièrement leurs travaux, leurs fatigues, et n’en tire néanmoins aucun profit. Son gain ne dépend pas, comme celui des industriels, de la peine de ses hommes. Leurs intérêts sont non plus opposés, mais semblables. L’autorité dont il est investi repose sur la loi, elle a une sanction légale, elle échappe à toute discussion, à tout compromis. Lui-même est soumis à cette discipline inflexible. Des règlements précis fixent la limite de ses exigences professionnelles. Tout concourt à dégager son indépendance personnelle et le désintéressement de son action.
C’est donc un merveilleux agent d’action sociale. Quel intérêt n’y aurait-il pas, si l’on se place au point de vue d’où nous sommes partis, à ce qu’avant tout autre il fût animé de l’amour personnel des humbles, pénétré
des devoirs nouveaux qui s’imposent à tous les dirigeants sociaux, convaincu de son rôle d’éducateur, résolu, sans rien modifier à la lettre des fonctions qu’il exerce, à les vivifier par l’esprit de sa mission ?
Et pourtant il est le seul à qui l’on ne songe pas. Ceux qui poussent la jeunesse dans les voies de l’action sociale ne prononcent pas son nom ; on ne semble pas imaginer qu’on puisse utiliser cette force puissante ; on ne se demande pas si le mouvement qui secoue la génération nouvelle ne pourrait être propagé dans le milieu militaire.
[…]
Il est incontestable que la nature du corps d’officiers s’est profondément modifiée et qu’à plus d’un égard, il est, dans son ensemble, supérieur à ceux qui l’ont précédé. Il semblerait que son action dût, par ce fait
seul, s’exercer avec plus d’efficacité, qu’on pût retrouver dans les hommes sortis de ses mains l’empreinte de ce progrès et constater que ce qu’il rend au pays vaut mieux que ce qu’il en reçoit.
Or, cela est-il ? Il résulte du moins des renseignements recueillis avec grand soin sur des points opposés, auprès de gens divisés d’origines et d’opinions, mais également adonnés à l’observation sociale, que, de leur passage dans l’armée, un bien grand nombre de jeunes gens rapportent dans leurs familles un sens moral diminué, le dédain de la vie simple et laborieuse, et, dans l’ordre physique, des habitudes d’intempérance et un sang vicié qu’ils transmettent. Si un tel résultat offrait hier déjà une extrême gravité, qu’en sera-t-il demain, alors que tout le monde, sans exception, passera par l’armée ? C’est là, n’est-ce pas, un douloureux, un terrible problème.
D’où peut donc venir cette apparente contradiction ? De ce que l’officier connaît trop peu ses hommes, s’intéresse trop peu à leur personne.
Tout contribue à l’en détourner. Si, d’abord, jamais l’importance de connaître sa troupe, de s’y intéresser, de la marquer d’une empreinte durable n’a été plus grande, jamais non plus il n’a été plus difficile de le faire : le service court, d’une part, accroît démesurément les contingents, et de l’autre laisse à peine le temps de les voir passer. Beaucoup plus de monde, pendant beaucoup moins de temps, voilà la formule à laquelle il aboutit. La solidarité ne s’établit plus comme jadis, machinalement pour ainsi dire : il faut la vouloir fermement, malgré les difficultés ; et, pour la vouloir ainsi, il faut être fermement convaincu que là réside le premier devoir, et qu’en dehors de toute considération sociale, au point de vue professionnel seul, une troupe bien en main, moins instruite, vaut mieux qu’une troupe plus instruite, moins en main.
Ensuite, il faut bien le dire, ce côté moral du rôle de l’officier, c’est ce dont on lui a le moins parlé. Tandis qu’en Russie les beaux enseignements du général Dragomirov concernant la mission morale de l’officier, nous ne dirons pas seulement font loi, mais formulent et résument l’idée mère qui anime le corps d’officiers, chez nous, bien qu’on admire ces écrits, que même on les lise, l’état d’esprit qu’ils dénotent n’existe qu’à l’état d’exception, et, dans ce cas, résulte de tendances individuelles et non d’une doctrine commune reçue comme un dogme au début de toute éducation militaire. À ceux qui viennent des écoles on a parlé stratégie, balistique, géographie ; on a cherché à développer leur intelligence militaire, mais bien peu leur coeur militaire : on leur a enseigné à instruire leurs hommes, leur a-t-on fait comprendre qu’il fallût d’abord les aimer et conquérir leur affection ?
Aux plus distingués on a donné comme objectif l’école de guerre, l’état-major, c’est-à-dire la vie de bureau, d’employé, qui draine chaque année davantage l’élite de l’armée ; de plus en plus, pour l’officier de choix, le
commandement de troupes semble un passage, une corvée à subir, durant laquelle il s’agit d’expédier le plus vite possible l’exercice professionnel pour garder le temps de se préparer à ses hautes destinées.
De ces considérations il résulte qu’un corps d’officiers très distingué, laborieux, dévoué à ses devoirs professionnels a sur l’âme de l’armée une action médiocre, tandis que le corps des officiers russes, par exemple, qui compte des personnalités éminentes, mais dans sa moyenne est, croyons-nous, moins cultivé que le nôtre, exerce sur l’âme de son armée une action immédiate et forte parce qu’il est pénétré de cette idée de patronat, de devoir social, qui fait défaut chez nous.
Mais cette action sociale de l’officier, quelle peut-elle être ? Représente-t-elle autre chose qu’une utopie généreuse, une illusion séduisante ? Sous quelle forme pratique peut-elle s’exercer ?
[…]
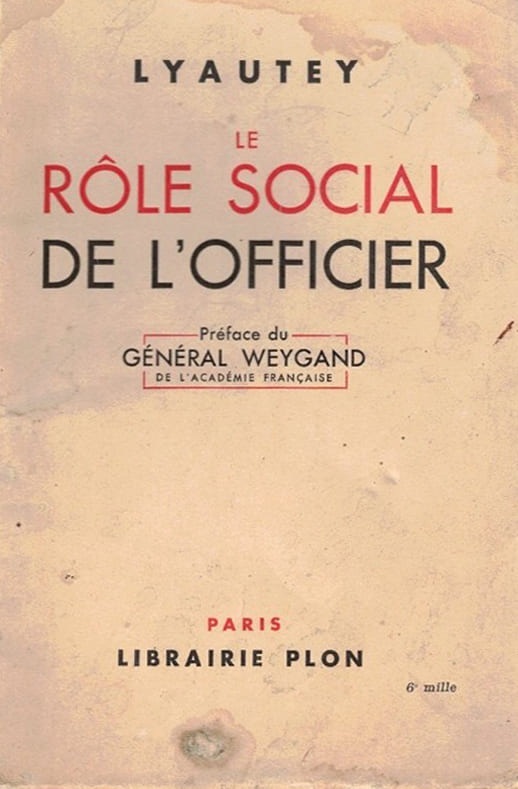
Au mois d’avril 1891, le capitaine Lyautey publiait dans la Revue des Deux Mondes, sans le signer, mais l’anonymat fut vite dévoilé, un article intitulé « Du rôle social de l’officier dans le service universel ». Le texte a ensuite été édité de très nombreuses fois, ici en 1935, avec une préface du général Weygand.
Pour la plupart, et des meilleurs, le devoir professionnel rempli et bien rempli, leur tâche est finie.
Avoir la troupe la plus manoeuvrière, les effets et le casernement les mieux entretenus, les chevaux les mieux dressés, et, comme sanction, la meilleure note de l’inspecteur général et le premier rang pour l’avancement, tel semble être le dernier mot de leur ambition. Personne d’ailleurs ne leur en demande davantage. En ce qui concerne la connaissance personnelle de leurs hommes, elle se borne à en savoir les noms (et encore pas toujours), dans une certaine mesure les aptitudes militaires — on sait dire habituellement s’ils sont bons, médiocres ou mauvais soldats —, quelquefois leurs professions antérieures, pour satisfaire certains inspecteurs généraux qui l’exigent, et puis c’est généralement tout.
Quant à leur caractère, à leur individualité morale, à leurs origines, au milieu où ils se sont formés, à tant d’éléments dont la connaissance peut donner la clef de ces natures si peu pénétrables et dont la mise en oeuvre peut faciliter si largement leur développement, c’est le dernier des soucis. On a tiré de l’écorce tout ce qui pouvait s’adapter au métier ; quant à la sève capable de donner la vie au mécanisme ainsi agencé, on n’a pas été jusqu’à elle. On a soigneusement étudié l’outil : le canon, le fusil, le cheval ; et le moins possible l’ouvrier, par qui seul pourtant vaudra l’outil. Cela est si vrai que dans la cavalerie, par exemple, il est extrêmement bien porté de connaître beaucoup mieux ses chevaux que ses hommes.
[…]
L’essentiel est de connaître parfaitement les hommes dont on a charge : nous savons tel officier qui dès l’arrivée d’un contingent commençait une véritable enquête sur ses recrues, profitant des relations qu’il pouvait avoir au centre de leur recrutement, écrivant dans les localités, s’informant de leurs familles, de leurs antécédents, de leurs aptitudes, de leurs ambitions. Avant même d’avoir parlé à aucun d’eux, ce travail souterrain, pour ainsi dire, lui avait donné une première notion de leur physionomie morale : les occasions d’entrer en relations s’offraient ensuite d’ellesmêmes ; les temps de repos pendant la manoeuvre, si avantageusement employés à cette communication individuelle, au lieu de se passer en bavardages entre collègues ou en temps de galop sur la piste voisine.
En témoignant à ses hommes cette sollicitude, en leur prouvant l’intérêt personnel qu’il leur porte, non par des discours, mais par des preuves directes tirées de la connaissance de leur personne et de leurs intérêts, l’officier acquiert forcément leur affection et leur confiance ; il est, de plus, merveilleusement préparé, et c’est essentiel, à son rôle permanent de justicier. Que de révoltes, de rancunes, de fautes graves, engageant parfois la vie entière, résultent d’une première punition infligée injustement ou à la légère, à défaut, presque toujours, d’une connaissance suffisante de l’individu qu’elle frappe !
Mais, plus encore qu’un justicier, l’officier est un arbitre ; un arbitre entre le soldat et le sous-officier : le plus souvent le simple soldat ne l’aime ni le déteste : il l’ignore, il le voit de loin, de bas, et ce qu’il perçoit seulement, c’est l’action directe des gradés inférieurs. C’est pour apprécier, modérer, régler l’action de ces agents, investis en France d’une autorité réglementaire plus grande que partout ailleurs, et si souvent sujets à caution, que la connaissance directe de ses hommes est indispensable à l’officier, tandis que, bien fréquemment, il ne les voit que par les yeux de ses sous-officiers dont il est trop disposé à accepter le verdict sans contrôle.
[…]
Indiquons seulement les conséquences qui, à notre sens, résulteraient de l’action de l’officier ainsi comprise et exercée.
Chez le soldat : au point de vue social, pacification des esprits soumis à ce régime, rendus plus réfractaires aux excitations de la haine de classes. Aujourd’hui déjà, revenus au pays, les soldats dont l’officier a gagné la confiance et l’estime restent volontiers en relation avec lui, nous en avons le témoignage, et ne manquent jamais de protester en ce qui le concerne contre les accusations dont les orateurs de cabaret accablent la corporation tout entière et avec elle le bourgeois, le patron, parmi lesquels elle est censée se recruter. Que ces exceptions se généralisent, qu’elles deviennent la règle, que le soldat, c’est-à-dire le peuple tout entier, ne rapporte du temps de son service que le souvenir d’une autorité bienfaisante, juste et respectable, et les accusations de ce genre seront sans crédit, les publications hostiles sans portée.
Au point de vue militaire, il nous semble ressortir suffisamment de ce qui précède que cette prise morale de la troupe est devenue une nécessité moderne. De la brièveté du temps de service et de l’espacement croissant des guerres, il résulte que, lors de la prochaine lutte, tout soldat verra le feu pour la première fois. Et quel feu ! — Le feu le plus meurtrier lancé d’une distance inconnue par une main invisible — la guerre la plus terrible sans aguerrissement préparatoire. — Ah ! devant une telle violence faite à tous les instincts naturels, l’instruction professionnelle, la discipline matérielle, les moyens répressifs feront triste figure si l’officier n’a pas d’autre secret au service de son autorité et si son regard, sa parole, son coeur n’ont pas su, dès le premier jour de leur rencontre, trouver le chemin de ces yeux, de ces oreilles, de ces coeurs d’enfants soumis brusquement à l’horreur d’une telle épreuve.
Chez l’officier, c’est, dès la paix, qui est en somme devenue l’état normal, l’introduction dans sa vie d’un élément du plus haut, du plus passionnant intérêt. Convenons-en ; l’officier ne se bat plus, pas plus souvent du moins que tout autre citoyen, une ou deux fois dans sa carrière, et c’est tout. Si donc l’on s’en tient à la vieille notion (et nous en sommes encore imbus) de l’état militaire entendu comme synonyme d’état guerrier, la condition actuelle d’officier ne serait qu’une anomalie et justifierait pleinement l’état d’esprit de toute cette jeunesse qui maudit aujourd’hui l’inaction forcée, la paix prolongée, l’arrêt complet de l’avancement, et n’a pas assez d’anathèmes contre la vie de garnison, sa monotonie, sa routine, sa stérilité.
Envisager au contraire le rôle de l’officier sous cet aspect nouveau d’agent social, appelé par la confiance de la patrie moins encore à préparer pour la lutte les bras de tous ses enfants qu’à discipliner leurs esprits, à former leurs âmes, à tremper leurs coeurs, n’est-ce pas, loin de l’amoindrir, l’élever dans les plus vastes proportions, le faire presque plus grand dans la paix que dans la guerre, et proposer à son activité l’objet le plus digne de l’enflammer ?
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2023-11/le-role-social-de-l-officier.html?item_id=7872
© Constructif
Imprimer
Envoyer par mail
Réagir à l'article